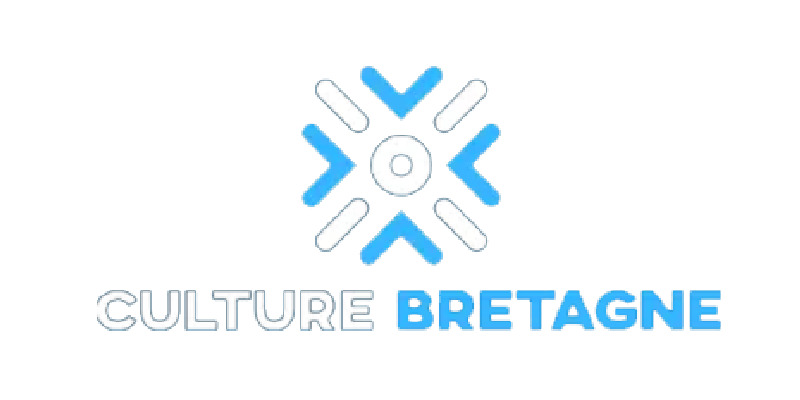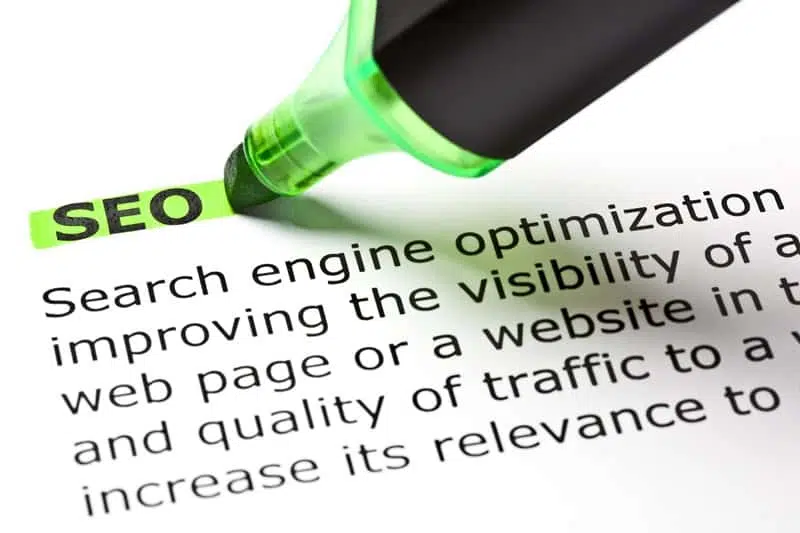63. Ce n’est pas la température d’un été torride ni le nombre de députés d’un petit parti d’opposition, c’est le nombre de banques américaines placées sous surveillance par la FDIC en mai 2024. Ce chiffre, en hausse, rappelle que les secousses bancaires ne sont jamais bien loin. Pendant ce temps, la Banque centrale européenne hausse le ton sur les risques qui pèsent sur le secteur immobilier commercial et la dette souveraine. Les dispositifs de protection des dépôts sont toujours là, mais leur capacité à absorber un choc majeur divise les économistes.
Banques en difficulté : où en est-on réellement aujourd’hui ?
Les faits sont têtus. Au printemps 2024, la FDIC a recensé 63 banques en difficulté aux États-Unis. Ce chiffre, en hausse par rapport à 2023, cible surtout les banques régionales américaines, mises à mal par la rapide ascension des taux d’intérêt et la chute de valeur de nombreux actifs immobiliers commerciaux. Dans ce climat, le mot crise bancaire revient en boucle sur les marchés, comme un écho lointain de la crise des subprimes qui a marqué les esprits.
L’Europe observe, en état d’alerte. La Banque centrale européenne s’inquiète des fragilités de certaines banques européennes, trop exposées à la dette publique ou à la baisse des prix de l’immobilier. Les résultats des stress-tests de juin 2024 montrent que plusieurs établissements de taille intermédiaire connaissent des tensions sur leur liquidité et leur solvabilité. Aucune faillite de banque majeure n’a secoué le Vieux Continent cette année, mais les signaux inquiétants se multiplient.
En France, la réputation de modèle prudentiel tient bon, sans pour autant garantir une immunité totale. Les banques françaises affichent une relative solidité, mais leur exposition aux marchés financiers et à l’inflation suscite des interrogations. Sous la surveillance renforcée de l’autorité de contrôle prudentiel, la gestion des fonds propres et des ratios de solvabilité fait l’objet d’un suivi méticuleux. L’évolution de l’endettement public et la hausse des taux pourraient toutefois mettre à l’épreuve cet équilibre déjà précaire. Le système financier paraît sous contrôle, mais la prudence reste de mise.
Quels sont les risques pour le secteur bancaire et les épargnants ?
Quand plusieurs banques en difficulté s’accumulent, le secteur bancaire se retrouve exposé à des risques multiples et interconnectés. Une correction brutale des marchés, associée à la hausse des taux d’intérêt, peut rapidement détériorer la liquidité et la solvabilité d’établissements déjà fragilisés. Le danger de l’effet domino est réel : la faillite d’une banque régionale américaine, par exemple, peut provoquer une onde de choc vers d’autres institutions, amplifiée par la défiance et l’interdépendance systémique. La dégradation de la note souveraine de certains pays, conséquence directe d’un endettement public grandissant, complique la capacité de soutien public en cas de tempête.
Pour les épargnants, la menace n’a plus rien d’abstrait. Un bank run, autrement dit un mouvement de panique qui pousse à retirer massivement les fonds, peut déclencher des blocages ou des restrictions d’accès aux comptes, comme cela s’est déjà vu lors de crises bancaires passées. La protection des dépôts agit alors comme dernier filet, mais son plafond, à 100 000 euros en France, ne couvre pas tous les patrimoines. Le rôle de l’autorité de contrôle prudentiel (ACPR) prend ici tout son sens : elle surveille de près les ratios de liquidité, les fonds propres et la politique de gestion des risques des établissements.
La surveillance des risques bancaires doit également intégrer d’autres menaces, désormais incontournables dans le paysage financier. Les risques climatiques et la multiplication des cyberattaques bousculent les modèles de gestion prudentielle. Pour les épargnants, rester informé sur la santé financière de leur banque, la qualité de sa note bancaire et sa politique de gestion des risques n’est plus une option.
Comprendre les dispositifs de protection des dépôts bancaires
La confiance dans le système bancaire repose en grande partie sur la garantie des dépôts, particulièrement en période de crise bancaire. En France, le fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) protège les montants déposés sur les comptes courants, livrets et produits similaires jusqu’à 100 000 euros par personne et par établissement. Ce mécanisme se déclenche uniquement lors de la défaillance d’une banque et s’étend, dans certaines conditions, à des contrats d’assurance vie via le fonds de garantie des assurés.
La réglementation européenne impose également des garde-fous stricts, orchestrés par le mécanisme de surveillance unique sous la houlette de la banque centrale européenne. En France, l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) vérifie la robustesse des établissements, anticipe les risques et veille à la stabilité du secteur.
Voici les principaux dispositifs mis en place pour couvrir les dépôts et certains placements :
- FGDR : protège les dépôts bancaires jusqu’à 100 000 euros
- Fonds de garantie des assurés : couvre certains contrats d’assurance
- Loi Sapin 2 : autorise un gel temporaire des contrats d’assurance vie si la stabilité financière est menacée
À noter : la garantie dépôts résolution ne concerne pas les titres financiers ni les parts de fonds d’investissement. Il est donc nécessaire de bien identifier la nature de chaque produit détenu. Les banques mutualistes françaises bénéficient du même régime que les grands groupes bancaires. Quant au conseil de stabilité financière, il supervise l’ensemble de ces dispositifs, tandis que la règle du renflouement interne (« bail-in ») limite désormais le recours à l’argent public en cas de défaillance d’un établissement.
Comment sécuriser son épargne en période d’incertitude financière ?
Face à l’agitation récente autour des banques en difficulté, la gestion de son épargne exige plus que jamais de la méthode et du discernement. Diversifier ses placements devient une évidence. Ne placez pas l’intégralité de vos économies sur un seul compte ou dans un seul établissement. Une répartition équilibrée entre comptes courants, livrets réglementés, fonds en euros et, pour ceux qui recherchent un niveau de protection supplémentaire, certains contrats d’assurance vie au Luxembourg, réputés pour leur super privilège en cas de défaillance de l’assureur, peut limiter les risques.
Rappelons que la garantie des dépôts s’applique jusqu’à 100 000 euros par banque et par déposant. Au-delà, les sommes ne bénéficient pas de la même couverture en cas de crise bancaire majeure. Les banques mutualistes françaises et les assureurs nationaux relèvent du même régime, mais l’attention se porte désormais sur les fonds investis dans l’immobilier, notamment via des SCPI ou OPCI, dont la valeur peut chuter ou les retraits être suspendus lorsque le marché de l’immobilier commercial se contracte.
Trois réflexes à adopter pour préserver ses avoirs, quelle que soit la conjoncture :
- Évaluez la répartition de vos fonds par établissement et par type de produit.
- Examinez la solidité financière des banques françaises et la notation des assureurs auprès desquels vous placez votre argent.
- Prenez en compte les risques de prélèvement forcé prévus par la loi Sapin 2 sur certains contrats d’assurance vie.
La fiscalité, elle aussi, évolue : la flat tax, l’IFI ou le taux marginal d’imposition peuvent modifier le rendement réel de vos placements. Avant d’arbitrer, intégrez à votre réflexion la rentabilité, la liquidité, mais aussi la robustesse des établissements financiers choisis. Quand les lignes bougent, mieux vaut garder un coup d’avance.